Conférences

Premier vote des femmes à Lyon, 1945, Archives Le Progrès.

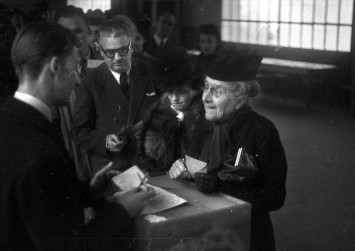
Premier vote des femmes à Lyon, 1945, Archives Le Progrès


Grand rouleau de l’abbaye de l’Ile-Barbe en cours de restauration, Arch. dép. métr. 10G3408.

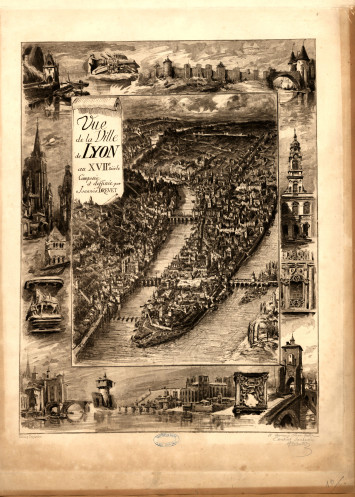
Vue générale de Lyon au XVIIe siècle, Arch.dép.mét., FGA116

